|
Isabelle Bonhoure |
|
Pour
les périodes anciennes, la vaisselle de cuisine ou de table est
principalement faite en céramique, un matériau qui a la
particularité d’être quasiment indestructible (contrairement
au métal ou au bois) et qui de ce fait est le matériel
archéologique par excellence. Par sa technologie comme par sa
plus ou moins grande commercialisation, la céramique est ainsi
un témoin de l’histoire socio-économique d’une
civilisation : elle renseigne sur les gestes quotidiens, le genre d’alimentation,
le luxe ou la pauvreté des habitations où elle est retrouvée.
Si pour chaque période de l’histoire, elle est marquée
par de grandes tendances, reflétant la culture commune de l’époque,
l’évolution des formes et des techniques reste bien souvent
très irrégulière d’une région à l’autre.
La céramique médiévale n’échappe pas à cette
règle.
|

Cruche en pâte calcaire émaillée à décors vert et brun de la
fin du XIV° siècle. Céramique fine.
|
| Mais,
malgré les disparités importantes qui existent selon
les zones géographiques, les céramiques médiévales
occidentales présentent une certaine unité, certaines
caractéristiques qui tranchent résolument avec celles
des périodes antérieures. Leur génèse
se fait tout au long du haut Moyen Age et surtout à l’époque
carolingienne (entre le VIIIe et le Xe siècle), une longue
période durant laquelle les techniques antiques sont progressivement
abandonnées et où des transformations se produisent
pour aboutir aux productions spécifiquement médiévales.
D’autre part un des faits les plus marquant pour cette période
est très certainement la réapparition et la généralisation
durable des céramiques glaçurées (glaçures
au plomb surtout) et l’introduction des faïences (céramiques émaillées
nécessitant deux ou trois cuissons). Mais ces transformations,
intervenues au contact de l’Orient, ne se sont pas produites
partout au même moment ni de la même manière, loin
s’en faut : en Occident, ces céramiques apparaissent
selon les régions entre le Xe et le XIVe siècle ! Les
productions glaçurées et les faïences sont donc
loin d’être caractéristiques de toutes les céramiques
médiévales. En fait, les poteries sans revêtement, à pâte
claire ou rouge et surtout à pâte grise, sont longtemps
les plus nombreuses. |
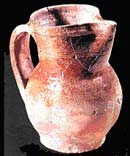
Cruche à pâte rouge glaçurée du XIV° siècle, Provence. Céramique commune. |
Tout au long du haut Moyen Age, la cuisson réductrice
(donnant des pâtes grises) s’était petit à petit
imposée. Si elle n’est déjà plus exclusive à l’époque
carolingienne, elle domine toutefois longtemps dans bien des endroits.
Dans le même temps, la distinction entre la vaisselle culinaire
et la vaisselle de table a tendance à disparaître et
il n’existe plus à un certain moment que la catégorie
des céramiques communes. De même, il n’existe plus
- ou très peu - de productions de céramiques de luxe
et leurs importations sont globalement assez rares. Les formes, au
départ héritées de l’Antiquité,
s’effacent peu à peu devant les apports des cultures
barbares venues de l’Est. Les formes ouvertes (bols, assiettes,
plats divers) se raréfient ; les formes carénées,
typiques de l’Antiquité, disparaissent ; les panses des
vases se font plus ventrues ; les fonds s’élargissent
et se bombent plus ou moins, ce qui donne une grande stabilité sur
un foyer ; le col est presque supprimé mais reste bien marqué ;
les cruches à bec ponté (becs tubulaires qui se soudent
sur la lèvre) se multiplient. Ces caractéristiques deviennent
typiques de la céramique commune médiévale, et
persistent, selon les zones, plus ou moins longtemps.
Ces transformations vont de paire avec l’apparition de nouveaux centres
de créations potières. Le phénomène le plus marquant
est sans doute la pulvérisation de la production en petits ateliers,
le plus souvent à diffusion locale, plus rarement régionale.
Il peut ainsi exister sur une grande région un seul type de céramiques
sans qu’il y ait une grande commercialisation des produits. En fait,
l’aire stylistique recouvre un ensemble de petits ateliers. |
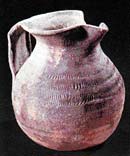
Pot à pâte grise, XII° siècle, Provence |
L’activité est en revanche plus grande et plus novatrice
dans les régions politiquement actives. C’est le cas de
l’Europe du Nord-Ouest, dominée par les régions
rhénane et mosane, où sont installés les grands
centres carolingiens, de l’Empire byzantin qui continue à avoir
son importance et enfin du monde islamique en pleine expansion. Ce sont
dans ces zones que peuvent apparaître des ateliers vraiment important
développant une réelle commercialisation (à grande échelle).
Ce sont dans ces zones aussi que sont introduites des techniques et
des recherches nouvelles, qui seront amenées à s’étendre.
Ainsi, la cuisson oxydante (qui donne des pâtes claires ou rouges) réapparaît
en Allemagne au IXe siècle dans deux grands ateliers de la région
de Cologne qui fonctionnent entre le VIIIe et le XIIe siècle : Badorf
(750-900 environ) et Pingsdorf (900-1200). Leurs productions sont diffusées
très loin dans toute l’Europe du Nord et impose un style, une
technique. Elles ont une réelle influence sur les poteries fabriquées
dans ces zones nordiques. Autour de Paris, par exemple, on trouve dès
les XIe-XIIe siècles des poteries à pâte claire décorées
de bandes peintes en rouge qui imitent les productions de Pingsdorf.
Dans les zones byzantines et islamiques, où l’utilisation des
glaçures n’a jamais été réellement abandonnée,
cette technique se développe et s’affine, par exemple avec l’association
d’un décor incisé (sgraffito). Dans le monde islamique
enfin, apparaissent de nouvelles techniques, largement en avance sur les productions
du monde chrétien : la faïence et le lustre métallique.
Poussées à un degré de maîtrise de plus en plus
grand, ces techniques sont utilisées pour fabriquer une magnifique et
luxueuse vaisselle de table. Très tôt il existe une large exportation
de la production islamique dans les zones méditerranéennes, et
plus tardivement (à partir du XIIIe siècle) une pénétration
dans les terres. Peu à peu, les influences orientales gagnent le monde
occidental, notamment par le biais de la péninsule ibérique,
où il y a une occupation arabe très forte, et par l’Italie.
Dans tout le bassin méditerranéen, des ateliers, désormais
plus importants et plus structurés que les précédents,
commencent à produire des faïences, et à les commercialiser à plus
ou moins grande échelle, alors que la vaisselle culinaire est désormais
glaçurée. Les formes se diversifient, notamment pour les céramiques
de tables : coupes et coupelles, plats, cruches sont les plus courantes, mais
il existe désormais une grande liberté. Les productions décorées
les plus représentatives pour ces périodes sont les céramiques
vertes et brunes produites dans plusieurs ateliers espagnols, en Italie et
un peu plus tard (à partir de la fin du XIIIe et surtout au XIVe siècle)
en Provence et Languedoc. Elles montrent une certaine unité de style
même si dans le détail on remarque certaines caractéristiques
propres à chaque région. Elles sont décorées le
plus souvent de motifs géométriques, mais aussi figuratifs avec,
dans les médaillons centraux des plats et coupes, des représentations
de végétaux, d’animaux et parfois des figures humaines.
Les céramiques bleus et blanches, parfois associées à du
lustre métallique, produites essentiellement à Valence, sont également
très appréciées à cette époque. |

Pot à pâte grise à décor
lissé du XI° siècle. Région Lyonnaise.

Pot à grise à bec porté et
décor lissé du XII° siècle . Ré g
ion Provençale |
La
céramique médiévale en Provence
L’exemple
provençal peut permettre d’illustrer un peu plus
dans le détail ce qui s’est produit à l’échelle
d’une région entre le XIe et le XIVe siècle.
Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la distinction entre la vaisselle
culinaire et la vaisselle de table n’existe pas. Les importations sont
quasiment inexistantes et seule la poterie grise, fabriquée localement,
domine. Réalisée dans des fours simples à cuisson réductrice,
elle est relativement imperméable. Les formes sont toujours tournées
avec soin et parfois décorées. On trouve ainsi des motifs géométriques
obtenus par lissage, selon une technique surtout utilisée au cours des
Xe et XIe siècles, quelques motifs d’ondes réalisés à l’aide
d’un peigne ou d’un morceau de bois, et surtout des motifs imprimés
en creux à l’aide d’une molette. |
|

Exemples de décors sur céramiques
grises du XII° siècle : Molette (à droite et à gauche)
et Onde incis ée (au centre) |
|
La
typologie, sans doute bien adaptée aux besoins, reste très
peu variée et évolue lentement. Il s’agit
le plus souvent de récipients assumant de multiples fonctions,
destinés à la fois à aller au feu, à être
présentés sur la table, ou encore à conserver
les aliments. Jusqu’au XIIe siècle, il n’y
a pratiquement que des pots globulaires de tailles diverses, les « pégaus »,
au fond légèrement bombé, avec ou sans anse,
parfois à bec ponté. Les formes ouvertes restent
extrêmement rares et il s’agit toujours de grandes
jattes ou mortiers. Enfin il existe quelques formes plus spécifiques
comme les couvres-feux, les bouteilles à goulot vertical
et deux anses, les gourdes, présentant la même forme
que les précédentes mais avec un flanc plat qui
permettait de les porter sur le côté. Quelques trompes
d’appel sont également fabriquées en céramique,
dans les mêmes ateliers. Cette vaisselle devait être
complétée de bols ou d’écuelles en
bois. A partir du XIIIe siècle, la typologie s’enrichit
de quelques cruches à col haut et bec simplement pincé et
surtout de marmites, au fond globulaires, présentant deux
anses opposées, de plus grande capacité que les
pots. La taille de ces derniers a alors tendance à diminuer
et on remarque désormais qu’ils comportent toujours
une anse.
|
|
Ces
céramiques sont produites dans de petits ateliers locaux
dont on connaît quelques exemples dans le pays d’Apt,
l’arrière-pays marseillais ou dans le Var. Seuls
les ateliers de l’Uzège dans la vallée
du Rhône, implantés à proximité des
gisements d’argile kaolinitique de très grande
qualité, ont connu une plus grande importance, ne dépassant
pas cependant une aire de commercialisation régionale.
A partir
de la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle,
on assiste au passage à la cuisson oxydante, au moment
où réapparaissent communément les glaçures
et les décors peints. Dans le même temps la
distinction entre vaisselle de table et vaisselle culinaire
refait surface. La production a tendance à se centraliser
(l’importance des ateliers de l’Uzège
s’accentue pour les poteries réfractaires) et
de nouveaux centres apparaissent, s’implantant auprès
de gisements d’argiles calcaires désormais utilisées
pour certaines céramiques non destinées aller
au feu (notamment les faïences). C’est aussi l’époque
où les échanges et le commerce connaissent
un nouvel et prodigieux essor. Les céramiques n’échappent
pas à ces nouvelles conditions économiques
: on recommence à trouver des importations, provenant
essentiellement d’Italie, d’Espagne et même
du Magreb ou du Proche-Orient.
Les formes vont alors se diversifier en fonction des multiples besoins
et deviennent plus spécialisées. Pour la céramique
commune, à présent à pâte claire ou rouge
et recouverte d’une glaçure plombifère, les marmites
et leurs couvercles dominent. S’y ajoutent de multiples cruches
qui remplacent peu à peu l’ancien « pégau ».
Les jattes, coupes, coupelles et écuelles font leur appararition
ainsi que quelques fait-tout ou poëlons. La vaisselle de table se
différencie nettement. Imitant au début les « majoliques
archaïques » à décor vert et brun sur fond blanc
d’Espagne ou encore le « sgraffito archaïque » d’Italie,
les ateliers provençaux adoptent très vite et utilisent
avec adresse les techniques mises au point ailleurs, leur donnant un
langage et un style propre.
Céramiques Culinaires à pâte rouge glaçurée
(XIV° siècle)
Lors de fouilles
archéologiques sur un habitats du
XIV° siècle (hôtel de Brion à Avignon),
on a retrouvé en proportion :
- 63,7 % de Marmites (A.)
- 21,2 % de Jattes (B. : ici, avec couvercle)
le reste du mobilier est constitué de formes diverses, dont :
- 7,4 % de couvercles
- 1,3 % de poêles et poêlons (C.)
- 4,2 % de gargoulettes (D.)
- 1,1% d’autres cruches
- 1,1% de lampes à huile
|

Marmitte Modèle A.

Couvercke de Jatte Modèle
B.

Jatte Modèle B.

Poêlon Modèle
C.

Gargoulette Modèle
D.
|
LES
ATELIERS
Pour des raisons pratiques,
les potiers installaient leurs ateliers à proximité des
matières premières dont ils avaient besoin : gisement
d’argile surtout, mais aussi bois pour alimenter les cuissons
et eau. Pour des raisons économiques, ils choisissaient de
préférence des lieux d’où ils pouvaient écouler
facilement leurs productions : dans le voisinage des grandes villes
ou près d’axes de communication. Mais à cause
des nuisances occasionnées par les cuissons (fumée,
risque d’incendie), les ateliers étaient toujours situés à l’extérieur
des agglomérations, soit à la campagne, soit à la
périphérie des villes importantes.
Les installations
utilisées par les potiers étaient toujours très
pauvres. Les ateliers médiévaux se réduisaient à un
ensemble de structures rudimentaires adaptées à chacune
des étapes de la transformation de l’argile de
carrière en poteries : différents espaces étaient
aménagés pour préparer et stocker la terre,
d’autres étaient réservés au tournage,
au séchage des poteries, aux fours ou encore au stockage
des produits finis.
L’importance des ateliers était très variable. Il existait
de modestes ateliers locaux mais également de grands ateliers regroupant
plusieurs artisans. |
|
LA
CUISSON DES POTERIES
Ultime phase de la fabrication des poteries, la cuisson en est aussi une des étapes
les plus délicates. Les potiers médiévaux étaient
parvenus à une grande maîtrise dans ce domaine, aussi bien dans
la fabrication des fours que dans la conduite du feu.
Les fours étaient
très souvent creusés dans le sol de façon à ce
que la plus grosse partie soit prise dans le substrat. De cette manière
ils présentaient une bonne étanchéité ainsi
qu’une bonne isolation thermique, ce qui permettait d’éviter
les pertes de chaleur. Enfin ils étaient suffisamment solides
et stables.
Les
fours comprenaient toujours trois parties essentielles -
Le foyer pour alimenter le four en combustible. Cette partie était
toujours enterrée. Une ouverture était ménagée à l’entrée.
A l’avant une « aire d’accès » était
creusée jusqu’au niveau de la porte du foyer pour permettre
aux potiers d’enfourner le bois.
- La chambre de cuisson où étaient entassées les poteries à cuire.
Certaines sont « permanentes », complètement construites avec
une ouverture ménagée à l’arrière pour enfourner
les céramiques. D’autres avaient seulement leurs parois permanentes,
la couverture étant reconstruite en matériaux légers à chaque
cuisson.
- Entre les deux se trouvait la sole, qui sert de support aux poteries. Il
s’agissait
souvent d’une plaque d’argile percée de trous reposant si
nécessaire sur un pilier ou sur une voûte. |
|
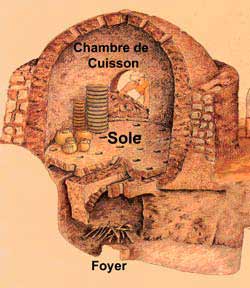 |
L’archéologie
permet de connaître plusieurs modèles de fours médiévaux,
les plus typiques étant les fours circulaires presque complètement
enterrés.
La conduite
du feu nécessite de maîtriser les trois facteurs
intervenant lors de la cuisson :
- La température
: elle doit être suffisante pour que les pots cuisent
mais ne doit pas dépasser le point de fusion de l’argile
- Le temps, élément complémentaire pour obtenir une cuisson
homogène. Deux grandes phases constituent le cycle de cuisson : la montée
en température, lente et progressive au début, plus rapide ensuite
et maintenue quelques temps à son maximum ; le refroidissement qui doit être
lent et progressif.
- La nature de l’atmosphère dans le four qui détermine l’aspect
des poteries : "atmosphère oxydante » (chargée d’air)
qui donne des pâtes beiges à rouges ou « atmosphère
réductrice » (privée d’air et chargée de fumée)
qui donne des pâtes grises à noires.
|
|
LES
CERAMIQUES GRISES (Xe-XIIIe siècles)
Les céramiques à pâte
grise sont pratiquement les seules productions existant dans les
régions du sud de la Loire jusqu’au XIIIe siècle.
Il s’agit d’une vaisselle commune assez frustre mais d’une
bonne qualité, bien adaptée en fait à l’utilisation
qu’on lui destinait.
Leurs formes sont variables selon les régions et les époques
mais elles restent d’une manière générale assez
peu nombreuses et elles évoluent lentement. Les mêmes poteries
servaient souvent à différentes fonctions : cuisson ou conservation
des aliments, cruches à liquide...
Ainsi il existe surtout des pots de tailles diverses, souvent avec une anse,
parfois à bec verseur.
La forme typiquement
médiévale consiste en un pot assez ventru, à large
ouverture, sans col marqué et à fond plat ou légèrement
bombé pour mieux s’adapter sur les braises.
On trouve également d’autres vases aux formes plus spécifiques
: des marmites à fond rond, quelques couvercles plats, plus rarement
des bouteilles ou des gourdes et enfin quelques jattes ou mortiers. C’est
là pratiquement tout le répertoire des formes produites durant
cette période. Il n’existe pas à proprement parler d’une
vaisselle de table. Celle-ci était fabriquée dans d’autres
matériaux, notamment en bois. |

Marmite à pâte grise, XII° siècle,
produite dans le Vaucluse. |
LES
CERAMIQUES DES XIVe-XVe siècles
C' est seulement à la fin du XIIIe siècle et surtout au XIVe
siècle que se produisit à la fois l’ouverture aux importations
de céramiques fines, venues parfois de régions lointaines, et
l’introduction d’une évolution technique : l’apparition
des glaçures, connues dans d’autres régions beaucoup plus
tôt. Les nouvelles productions à pâte claire ou rouge et
glaçurée ne tardèrent pas à supplanter presque
totalement les anciennes poteries à pâte grise.
Les formes se diversifient
très largement et en même temps se spécialisent.
On trouve tout d’abord la vaisselle commune avec des poteries culinaires
comme les marmites, les jattes, les poêlons, les couvercles, etc... et
les poteries de table avec de nombreuses cruches, des gobelets ou des chopes,
des bols et écuelles...
A côté de cette production commune, on importe et bientôt
on produit dans nos régions des poteries finement décorées,
beaucoup plus luxueuses, destinées aux tables des gens riches. Les plus
typiques sont les céramiques « vertes et brunes », ornées
de motifs géométriques, animaliers, floraux... |
|
GLOSSAIRE
Les
argiles
En fonction des argiles utilisées, on obtient différentes
catégories de céramiques. On distingue surtout les céramiques
culinaires, qui supportent les chocs thermiques, fabriquées à partir
d’argile réfractaire (notamment les argiles kaolinites)
et les céramiques de table fabriquées à partir d’argiles
calcaires qui ne peuvent être destinées au feu.
La
cuisson
Le type de four et l’atmosphère de cuisson et de post-cuisson
sont fondamentales pour déterminer le type de cuisson : dans un
four à bois, lorsque la chambre de cuisson et le foyer communique,
l’atmosphère peut être ou non chargé d’oxyde
de carbone. La cuisson réductrice est obtenue par réduction
de l’oxygène dans le four, en fermant hermétiquement
toutes les ouvertures. Les céramiques prennent une teinte grise
par enfumage et réaction de la pâte. L’atmosphère
oxydante, au contraire, développe l’oxyde ferrique et donne
des teintes claires ou rouges (par oxydation du fer contenu dans l’argile).
On obtient donc une cuisson oxydante en ménageant dans le four
quelques ouvertures, permettant à l’oxygène de circuler.
Les
glaçures
Au Moyen Age, les vernis sont le plus souvent fait avec du plomb. Leur
fonction est avant tout d’imperméabiliser la céramique
par vitrification.
Le vernis plombifère est transparent. S’il est d’une
pureté parfaite, il prend la couleur de la pâte, mais généralement
les teintes varient du brun au vert. Le vernis peut être opacifié avec
de l’étain. On a alors tendance à parler d’émail
ou de faïence. La coloration est obtenue par des oxydes. L’étain,
surtout utilisé pour les fonds, donne du blanc, le cobalt du bleu,
le cuivre du vert, le manganèse des teintes allant du brun au
violet, le fer du jaune ou du brun, l’antimoine du jaune.
Les glaçures peuvent être passées sur « cru »,
lorsqu’on a besoin de la même température de cuisson
entre la pâte et le revêtement - c’est surtout le cas
pour les glaçures plombifères - ou sur « biscuit » (poterie
cuite), ce qui est le cas de toutes les faïences. |
|



